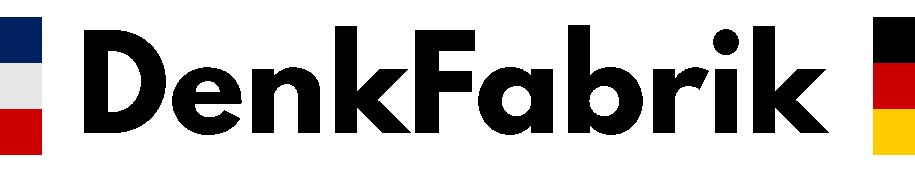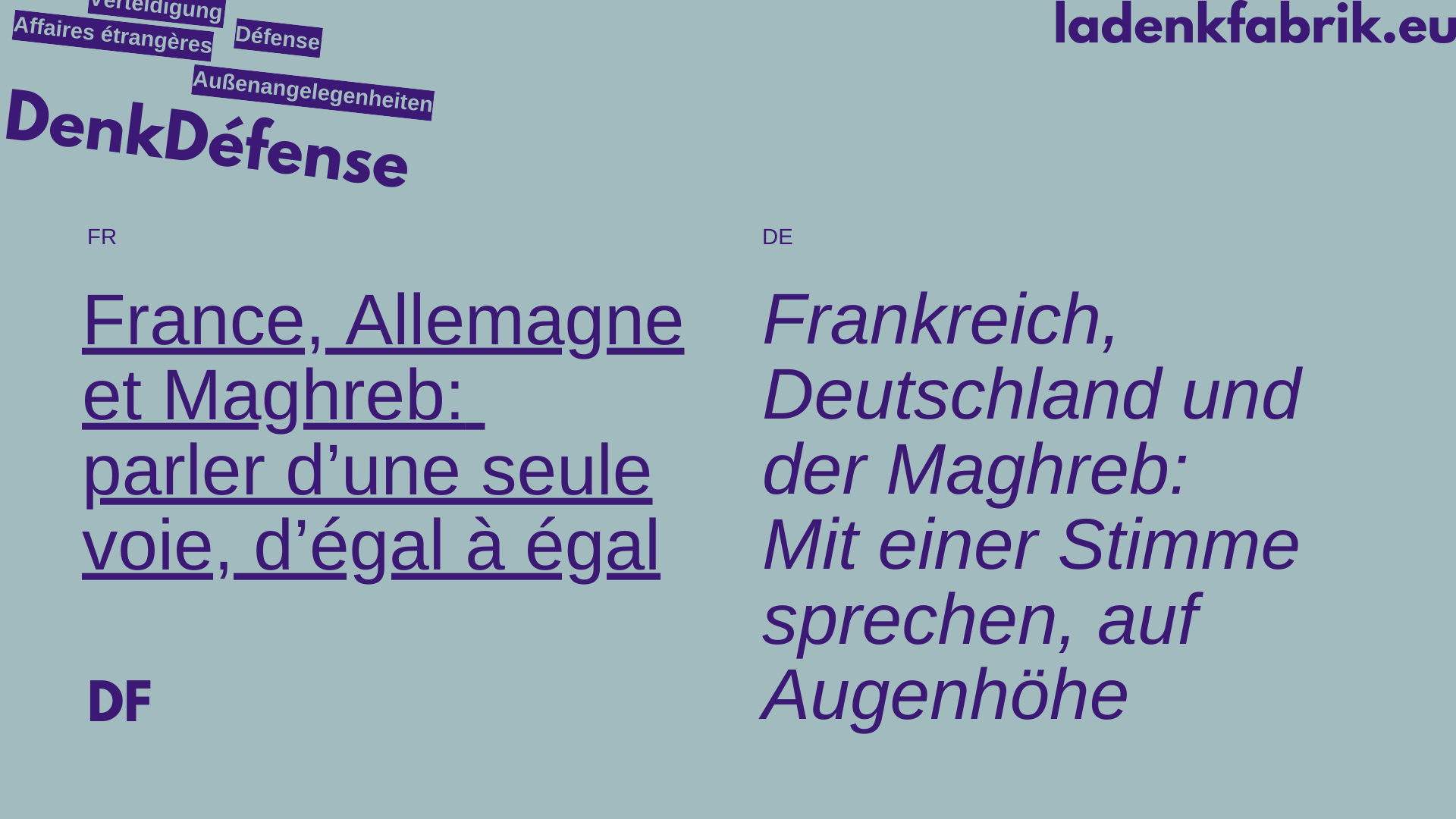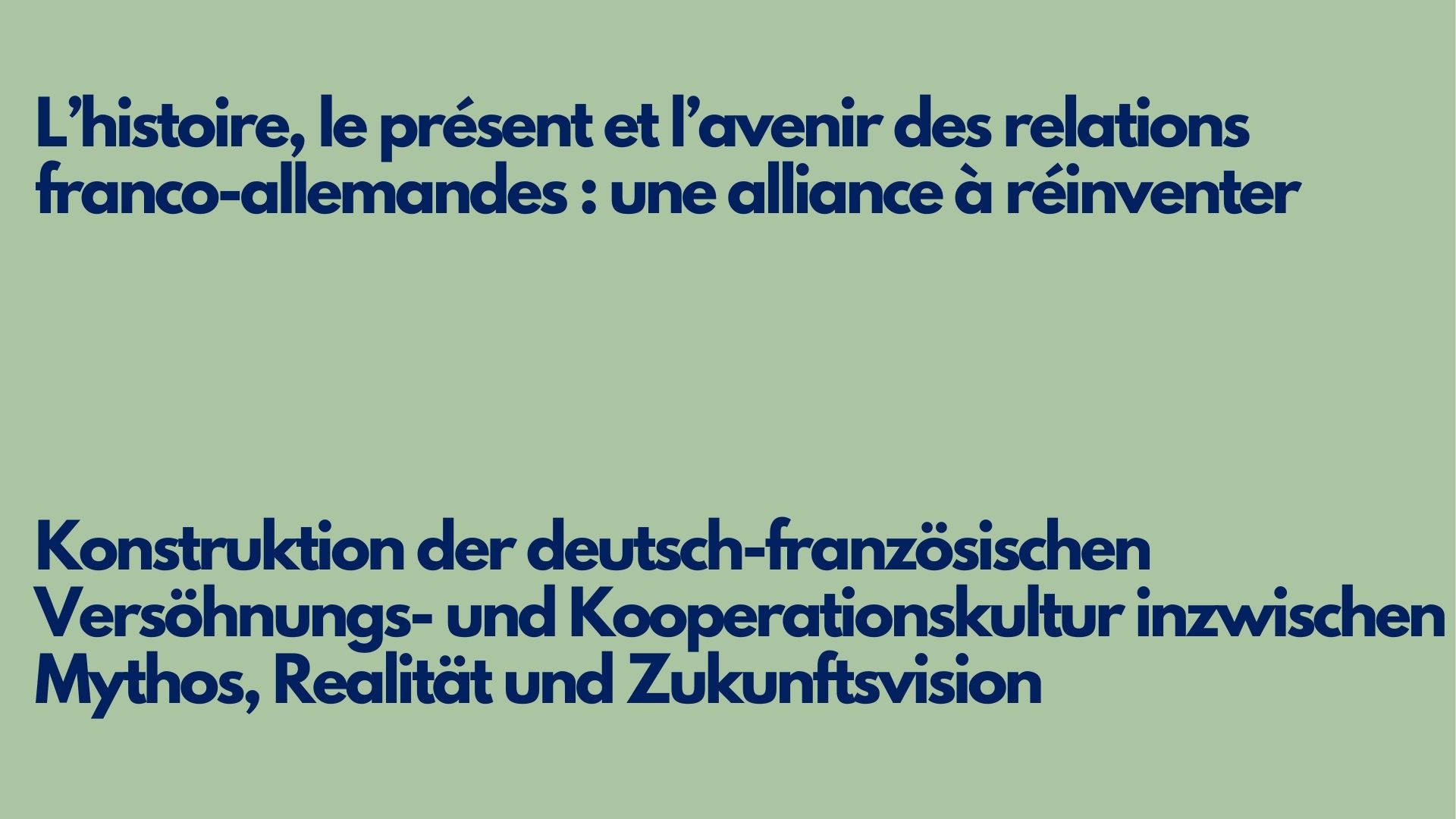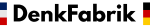Une histoire de grands gestes
L’histoire des relations franco-allemandes est marquée par le sang, la haine et la guerre. De la guerre franco-prussienne de 1870-71 à la Première Guerre mondiale, jusqu’à la catastrophe de 1939 à 1945, les deux nations se sont affrontées dans une hostilité que l’on a longtemps considérée comme héréditaire. Des millions de morts, des pays ravagés, une méfiance profonde : rares sont les États européens dont l’histoire commune est aussi conflictuelle. Et pourtant, quelques années seulement après la Seconde Guerre mondiale, la France et la République fédérale d’Allemagne ont entamé un processus de rapprochement sans précédent dans l’histoire mondiale.
C’est le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, qui posa en 1950 la première pierre de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) – une proposition radicale : placer les ressources économiques et stratégiques clés des deux pays sous une gestion commune. L’objectif : rendre une nouvelle guerre entre la France et l’Allemagne « non seulement impensable, mais matériellement impossible ». Ce projet n’était pas une vision romantique, mais une décision rationnelle face à la nécessité. La guerre froide s’annonçait, et les États-Unis pressaient pour une unification de l’Europe comme rempart contre le communisme.
Certes, la Communauté européenne de défense (CED) échoua en 1954 devant le Parlement français, mais l’orientation était claire : faire des anciens ennemis des partenaires. Les traités de Rome (1957) et surtout le traité de l’Élysée (1963) ont fait de la coopération franco-allemande le socle de l’unification européenne. Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, figures symboliques de la réconciliation, ont inauguré une nouvelle ère fondée sur la coopération plutôt que sur la confrontation.
Ce regard lucide sur l’origine de cette relation révèle une vérité dérangeante : l’amitié franco-allemande ne fut pas un coup de foudre, mais un mariage arrangé – né des ruines de deux guerres mondiales, de la nécessité de la paix et de l’urgence de sécuriser l’avenir de l’Europe. Ce qui avait commencé en 1945 comme un « Plus jamais la guerre » devint dans les années 1950 une coopération pragmatique. La realpolitik de la réconciliation imposa une intégration fonctionnelle. Avec le plan Schuman et les efforts pour construire une défense européenne, la direction était claire : la paix par l’intégration. L’amitié était le moyen, non la finalité.
Cette amitié franco-allemande fut donc ambivalente dès le début. Le traité de l’Élysée fut célébré en France comme un acte de souveraineté retrouvée, alors qu’en Allemagne, une résolution du Bundestag l’inscrivait explicitement dans le cadre du partenariat transatlantique. Ainsi se créa une tension persistante entre intégration européenne et stratégie nationale, qui perdure encore.
Quand les rituels deviennent des mises en scène
Dans la pratique, un dense réseau de relations bilatérales s’est mis en place : conseils ministériels conjoints, commissions intergouvernementales, programmes d’échange comme Voltaire ou Erasmus+, l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), l’Université franco-allemande, des coopérations médiatiques comme ARTE, et une multitude de jumelages. Leur efficacité peut se mesurer empiriquement (par exemple 180 000 boursiers de l’OFAJ depuis 1963), mais la cohésion sociale profonde reste difficile à quantifier. Cette densité symbolique s’est souvent concentrée dans de grands gestes : comme lorsque Helmut Kohl et François Mitterrand se sont tenus la main à Verdun en 1984, ou quand Emmanuel Macron et Angela Merkel ont signé le traité d’Aix-la-Chapelle en 2019.
Aujourd’hui, une partie de cela est devenue ritualisée. Les échanges scolaires, les réunions de cabinets, les jumelages – autant d’outils utiles, mais qui donnent parfois l’impression d’être des mises en scène imposées d’en haut. Il ne manque pas de gestes, mais de crédibilité. Ce ne sont pas les structures qui manquent, mais l’âme. La relation entre Paris et Berlin est saturée de symboles, mais parfois étonnamment vide quand il s’agit de coopération concrète. Chez les jeunes, l’axe franco-allemand perd de sa pertinence. Les compétences linguistiques diminuent. En Allemagne, à peine 15 % des élèves apprennent encore le français. En France, l’allemand est devenu marginal. Les échanges stagnent, les liens culturels s’amenuisent.
La connaissance de l’autre s’effrite : politique, société, histoire – tout cela devient flou. Et les tensions fondamentales n’ont pas disparu, elles ont simplement changé de forme. En matière économique, l’austérité allemande s’oppose à la volonté d’investissement française. Sur l’énergie, on se divise autour du nucléaire et des objectifs climatiques. Tandis que l’Allemagne se voit comme une puissance régulatrice au cœur de l’UE, la France revendique une autonomie stratégique – notamment face à la Chine, aux États-Unis, ou dans le domaine de la défense. Le grand projet d’une défense européenne commune reste paralysé par des égoïsmes nationaux : l’Allemagne hésite, la France pousse.
Mais le problème est plus profond encore : la relation franco-allemande reste trop gérée par les élites politiques, et pas assez vécue par les sociétés. Il est commode d’inscrire l’amitié dans des traités. Mais aucune institution ne remplacera jamais l’émotion. Et c’est justement d’émotion qu’il faut, si une relation doit survivre à travers les générations.
Pas d’Europe sans entente franco-allemande
En réalité, la cohésion interne de l’Europe est aujourd’hui aussi menacée que sa position géopolitique externe. La guerre en Ukraine a rebattu les cartes. L’Europe de l’Est exige légitimement plus d’influence. Les États-Unis se tournent vers le Pacifique. Dans ce contexte, l’Europe ne peut se permettre une fragilisation de l’axe franco-allemand. Au contraire, celui-ci doit se renforcer : plus ambitieux, plus radical, plus visionnaire.
Car là encore, une évidence s’impose : sans centre uni, l’UE se disloquera. Cela nécessite un dialogue étroit avec l’Est européen, dont les positions sont souvent très éloignées et les contraintes géopolitiques différentes. Mais avant d’envisager sérieusement cette coopération, il faut admettre une vérité : l’unité franco-allemande est une condition préalable à tout partenariat sérieux avec l’Est. Qui parle d’élargissement doit aussi parler d’approfondissement – et celui-ci commence avec ceux qui ont inventé l’Europe.
Ces divergences ne sont pas que techniques. Elles sont le reflet d’identités culturelles et politiques profondément ancrées. La France se vit comme une puissance stratégique à vocation mondiale ; l’Allemagne comme une puissance pragmatique dans un ordre fondé sur des règles. Ces visions s’opposent, notamment sur la dissuasion nucléaire, les exportations d’armes ou la politique industrielle européenne.
Il ne suffit plus d’invoquer la nécessité d’une union des marchés financiers, d’une meilleure coopération économique ou d’une coordination politique renforcée. Si le chancelier allemand croit véritablement en l’Europe, il faudra plus que des formules diplomatiques. Une véritable relance de la relation franco-allemande pourrait s’articuler autour de six propositions concrètes :
Six propositions pour un véritable renouveau
- Le français comme langue obligatoire au collège
La proximité naît de la compréhension linguistique. Elle ne peut être imposée, mais encouragée. Le français doit retrouver sa place dans les programmes scolaires allemands – obligatoire et soutenu. Et inversement, l’allemand doit être valorisé à nouveau en France. - Reconnaissance de la polyvalence diplomatique
Les divergences en matière de politique étrangère au sein de l’Union européenne, et en particulier entre la France et l’Allemagne, ont souvent été perçues comme une faiblesse. Pourtant, le très attendu « parler d’une seule voix » dans les communiqués reste bien souvent un acte purement déclaratif. À l’inverse, la capacité à adopter des positions différentes, à mobiliser divers canaux diplomatiques et à faire entendre une pluralité de points de vue pourrait être envisagée comme une force. Tant qu’elle reste orientée vers un objectif commun, une telle politique étrangère complémentaire peut renforcer la relation bilatérale – et envoyer un signal fort à l’ensemble de l’Union européenne. - Relancer une industrie de défense commune
Les projets bilatéraux de défense ont historiquement joué un rôle nécessaire, d’abord pour désamorcer les potentiels de conflit, puis pour éviter la concurrence entre programmes nationaux. Aujourd’hui, ils ne sont plus adaptés aux défis à venir. Les intérêts particuliers, le lobbying des entreprises impliquées et les difficultés logistiques liées à l’intégration politique d’États tiers entravent une industrie réellement efficace. L’Europe a besoin d’une armée unifiée, fondée sur des standards, une formation, un marché et une stratégie communs. L’Allemagne et la France doivent en prendre la tête. Elles peuvent s’appuyer pour cela sur l’expérience de la Brigade franco-allemande. Sur le plan industriel, cela implique : des normes d’homologation standardisées (équivalentes à des normes européennes STANAG), une gestion de programme commune pour les grands projets, ainsi qu’une plateforme d’interopérabilité à l’échelle du continent, capable d’intégrer des systèmes habités comme non habités. - Réalisme sur la dissuasion nucléaire
L’extension proposée du parapluie nucléaire français ne constitue qu’une réponse de façade – principalement motivée par des considérations budgétaires – au défi de la dissuasion nucléaire. Les capacités actuelles ne suffisent pas à garantir une dissuasion crédible. Une solution préférable serait la création d’un bouclier européen, fondé sur un partage des capacités restantes des puissances nucléaires européennes et sur de nouveaux développements à coûts maîtrisables. Concrètement, les systèmes de lancement resteraient formellement sous souveraineté nationale, mais les décisions concernant les seuils d’emploi, la sécurité du stockage et les procédures de crise seraient confiées à un organe multilatéral, placé sous supervision parlementaire, sur la base d’un accord définissant le partage des charges, les infrastructures communes d’alerte et de sécurité, ainsi que la modernisation technique partagée. Une gestion décentralisée et une administration européenne de ces moyens renforceraient en outre la capacité de seconde frappe – à condition qu’elle s’appuie sur un accord préalable sur les compétences en matière de défense. - Un fonds européen pour la recherche technologique
Sur la base des ambitions numériques déjà existantes, il faut créer un fonds de recherche ciblé et opérationnel, capable de relier les avancées de la deep tech à des applications industrielles concrètes. Ce fonds collaborerait avec des centres de compétence régionaux – des campus de recherche dans des zones technologiquement fortes où se croisent universités, financements publics et capital-risque. Les critères de financement devraient viser des technologies stratégiques : intelligence artificielle, communication quantique, cloud sécurisé, stockage d’énergie verte. Les mécanismes de propriété intellectuelle devront garantir que les entreprises européennes puissent tirer un bénéfice durable des recherches financées par des fonds publics. Des standards ouverts, une interopérabilité obligatoire et une forte orientation vers la création d’entreprises assureront que la recherche soit traduite en produits et en emplois. - Suppression des barrières non tarifaires
Le marché intérieur européen souffre encore d’obstacles pratiques qui pourraient être levés par des solutions techniques et administratives claires. Il faut créer des « One-Stop-Shops » (guichets uniques numériques) pour la création d’entreprises transfrontalières, des procédures automatiques de reconnaissance des qualifications professionnelles via des plateformes d’identité interopérables, ainsi que des règles harmonisées de passation de marchés pour les infrastructures critiques. Les outils de soutien public – banques de développement, agences d’innovation – devraient regrouper leurs programmes pour des projets transfrontaliers et faciliter l’accès au capital à travers des lignes de crédit communes. Du côté administratif, un système bilatéral d’ombudsman pour les litiges commerciaux permettrait de trancher rapidement. Ces réformes opérationnelles stimuleraient l’investissement, réduiraient les délais de mise sur le marché et instaureraient la confiance, notamment parmi les PME et les start-ups. Mieux encore : testées dans le cadre bilatéral, elles pourraient devenir le moteur de réformes européennes plus larges.
L’Union européenne ne peut se contenter de tirer sa légitimité du passé. Si elle veut exister demain, elle doit affirmer une vision d’avenir. Il ne suffit pas que le chancelier et le président s’entendent bien. Il ne suffit pas que des enfants agitent des drapeaux ou que des maires entretiennent des jumelages. Il faut que la relation entre États devienne une amitié entre peuples – par la langue, l’échange, la responsabilité partagée et les rêves communs.
L’amitié franco-allemande n’est pas une évidence historique. C’est une invention artificielle, historique et anormale – et, à ce titre, elle doit être entretenue, améliorée, parfois repensée. Non comme un rituel, mais comme un acte politique. Non comme un devoir, mais comme un engagement passionné pour une Europe qui ne soit pas qu’un marché. Une Europe qui ne se limite pas à son passé. Une Europe qui veuille encore être avenir.